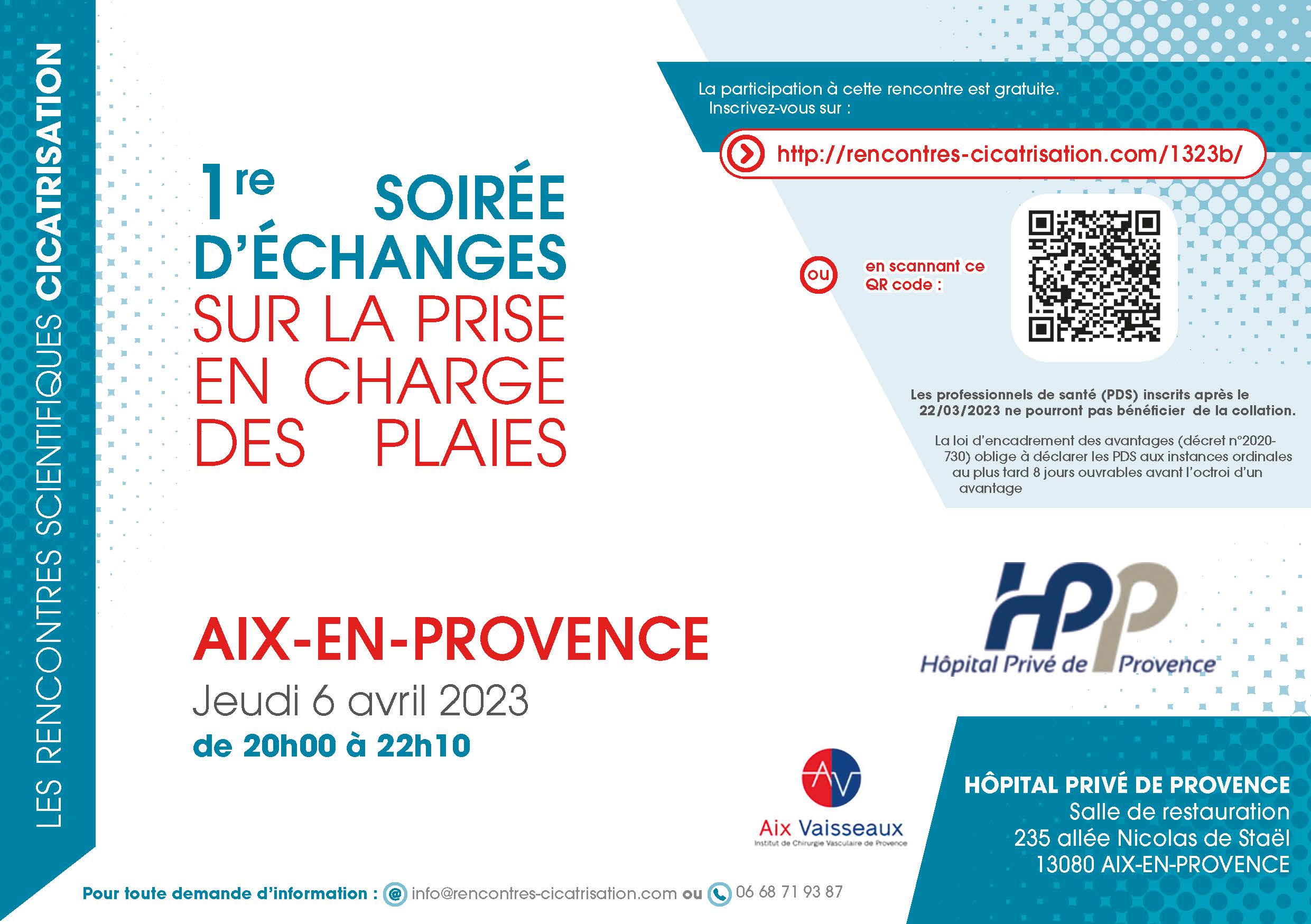
Dans le langage courant, la pharmacie est le lieu où chacun peut se rendre afin d’acheter des médicaments et des produits de santé. Cependant, la pharmacie est en réalité un secteur bien plus vaste, composé de sous-domaines distincts, expliquant la diversité des métiers liés au domaine pharmaceutique.
En effet, le secteur de la pharmacie se décline en cinq grands domaines :
- l’officine de pharmacie ;
- la biologie ;
- l’hôpital ;
- la distribution en gros ;
- l’industrie.
Chacun de ces domaines s’occupe d’un aspect précis du secteur de la pharmacie. Les métiers de la pharmacie diffèrent ainsi en fonction des missions que chaque domaine doit remplir pour assurer un accès constant aux produits de santé et continuer de faire évoluer la pratique.
Les métiers de l’officine de pharmacie :
L’officine de pharmacie est le lieu où il est possible d’acheter des médicaments et des produits de santé. Nous l’appelons plus communément et plus simplement la pharmacie.
L’officine de pharmacie a donc pour but de délivrer des médicaments sous ordonnance, des médicaments sans ordonnance ainsi que d’autres produits de santé ou encore de bien-être. Les pharmaciens d’officine sont également chargés d’exécuter les préparations magistrales ou officinales. Il possède également un rôle de conseiller auprès de sa clientèle.
Au sein d’une officine de pharmacies, plusieurs métiers sont regroupés :
le pharmacien titulaire : il est le propriétaire de la pharmacie d’officine ;
le pharmacien adjoint : il assiste le pharmacien titulaire dans ses tâches ;
le préparateur en pharmacie : il assiste le pharmacien titulaire dans la préparation et la délivrance des médicaments au public ;
le stagiaire en pharmacie : étudiant en pharmacie, il assiste également l’équipe officinale avant de peut-être à son tour devenir pharmacien ou gérant de pharmacie.
De nombreuses officines de pharmacie font aujourd’hui appel à des employés polyvalents (ou rayonniste en pharmacie) chargés de seconder l’équipe officinale dans la gestion des stocks notamment.
Pour devenir pharmacien en officine, il est nécessaire d’obtenir un Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie. Au 1er janvier 2019, les pharmaciens d’officines étaient plus de 26 000 en France pour presque 21 000 officines de pharmacie sur le territoire selon l’Ordre National des Pharmaciens.

Le secteur de la biologie médicale :
Dans le domaine de la biologie, le principal métier est celui du biologiste médical. Son rôle principal est d’effectuer les examens visant à mesurer les différents constituants des échantillons biologiques (urine, sang, liquide céphalo-rachidien, etc.).
Le biologiste médical permet ainsi de :
contribuer au diagnostic d’une maladie ;
suivre le cours d’une maladie ;
surveiller un traitement et vérifier la prescription ;
assister à la procréation.
Le biologiste médical travaille dans un laboratoire de biologie médical (LBM). Au 1er janvier 2019, plus de 7000 pharmaciens biologistes étaient inscrits au tableau de l’Ordre national des pharmaciens.
Pour devenir biologiste médical, il est nécessaire d’obtenir un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ainsi que la validation d’un internat spécialisé en biologie médicale.
Le secteur de la pharmacie hospitalière
Les hôpitaux et établissements de santé qu’ils soient publics ou privés possèdent également des pharmaciens spécialisés en pharmacie hospitalière ainsi que des attachés et assistants.
Les missions du pharmacien hospitalier sont notamment de :
- gérer l’achat et l’approvisionnement des médicaments et produits de santé dans l’établissement de santé ;
- dispenser les produits de santé aux patients hospitalisés ou ambulatoires ;
- vérifier les doses et conseiller les patients sur le bon usage des médicaments ;
- réaliser des préparations magistrales, hospitalières et officinales ;
- assurer la traçabilité et la sécurité des médicaments circulant dans l’hôpital.
Pour devenir pharmacien hospitalier, il est nécessaire d’obtenir un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie avec une spécialité en pharmacie hospitalière obtenue après un internet en hôpital. Au 1er janvier 2019, les pharmaciens hospitaliers étaient plus de 4400 dans le secteur public et plus de 2000 dans le secteur privé.

Les métiers de la distribution de médicaments :
Pour pouvoir fournir les établissements de santé ainsi que les pharmacies d’officines, un secteur est essentiel : celui de la distribution en gros. Plusieurs métiers existent ainsi pour remplir cette mission :
Les grossistes répartiteurs : ils livrent les médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l’homme en vue de leur distribution en gros. 200 agences existent sur le territoire afin d’approvisionner l’ensemble du réseau pharmaceutique officinal en France ;
les dépositaires : ils sont des prestataires qui stockent pour le compte d’un ou plusieurs exploitants de médicaments des produits en vue de leur distribution en gros ;
les distributeurs en gros à l’exportation : ils exportent les médicaments en dehors du territoire de la France ;
les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments : ils livrent dans un but humanitaire ou des médicaments et produits expérimentaux.
Les entreprises chargées de la distribution pharmaceutique doivent être gérées par un pharmacien responsable qui aura pour rôle de respecter les dispositions relatives au secteur. Ils peuvent être assistés de pharmaciens délégués.
Pour exercer le métier de grossiste répartiteur, il est également nécessaire de disposer d’un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.

Les métiers de l’industrie pharmaceutique :
Tout comme pour les entreprises chargées de la distribution de médicaments, les entreprises chargées de la fabrication des médicaments doivent être supervisées par des pharmaciens responsables.
Dans le cadre de l’industrie pharmaceutique, le pharmacien responsable est notamment chargé de :
l’organisation et le suivi des études cliniques ;
la sélection et la formation des investigateurs ;
la vérification de l’approvisionnement en médicaments expérimentaux ;
la gestion et la traçabilité des essais.
Pour devenir pharmacien responsable, il est nécessaire de disposer d’un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie. En parallèle, une formation en recherche ou développement cliniques est fortement recommandée.

Le gouvernement va déposer un amendement au projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour rallonger de 600 millions d’euros le budget des hôpitaux en 2023. Face à un système « à bout de souffle » sur fond de triple épidémie hivernale, Emmanuel Macron avait déjà annoncé début janvier des mesures.
« Le président de la République a annoncé des mesures fortes pour l’hôpital (…) Vous savez que, notamment pour le travail de nuit, il y avait des majorations pour les personnels de santé (…) Le président de la République a annoncé qu’on allait les prolonger », a-t-il ajouté. Face à un système « à bout de souffle » de l’aveu même du gouvernement, avec des urgences débordées et un manque criant de personnels, sur fond de triple épidémie hivernale de Covid-19, grippe et bronchiolite, Emmanuel Macron avait annoncé début janvier une réorganisation de l’hôpital et des mesures pour faciliter l’accès aux soins.
Des mesures pour soutenir les soignants qui travaillent la nuit :
Il avait aussi annoncé la « sortie de la tarification à l’acte » à l’hôpital dès le prochain budget de la Sécurité sociale. Des mesures plutôt bien reçues dans le milieu hospitalier. « Il y a d’autres mesures qui vont venir soutenir les soignants notamment qui travaillent la nuit », a précisé lundi Gabriel Attal. Le coup d’envoi des débats sur le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale sera donné à 16 heures lundi, dans un hémicycle qui s’annonce archicomble pour ce texte qui abrite la réforme phare du second quinquennat d’Emmanuel Macron : le report de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite.
« C’est un texte financier sur le budget de la Sécurité Sociale, donc il y a d’autres sujets qui seront abordés », a indiqué Gabriel Attal pour expliquer l’amendement sur le budget de l’hôpital. Interrogé sur le financement de cette mesure, il a précisé que l’objectif de déficit public pour l’année 2023 restait à 5% du PIB et que le gouvernement s’était gardé la « possibilité, notamment sur le budget de l’hôpital d’accroître son engagement » après les annonces du président. « On en avait tenu compte dans les prévisions qu’on a faites », a dit le ministre.
Covid-19 : la prise en charge des tests de dépistage évolue
À partir du 1er mars 2023, la prise en charge par l’Assurance maladie des tests de dépistage Covid antigéniques et RT-PCR et des tests sérologiques, évolue. Un ticket modérateur s’applique désormais à tous les assurés, sans distinction entre les vaccinés et les non-vaccinés, sauf pour certaines personnes pour lesquelles la prise en charge est maintenue à 100 %. Un arrêté publié au Journal officiel du 28 février 2023 modifie les règles de prise en charge du dépistage du virus SARS-CoV-2.
L’amélioration de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en France permet d’adapter la stratégie de dépistage.
La prise en charge à 100 % des tests Covid par l’Assurance maladie pour toutes les personnes vaccinées prend fin le 1er mars 2023.
L’arrêté du 27 février 2023 limite la liste des personnes pour lesquelles les tests de dépistage de la Covid-19 sont intégralement pris en charge par la Sécurité sociale.
À partir du 1er mars 2023, la prise en charge des tests de dépistage (antigéniques, RT-PCR) s’effectue sans prescription médicale préalable avec la mise en place du ticket modérateur (reste à charge), sauf pour certaines personnes qui bénéficient d’une prise en charge à 100 % :
- les personnes reconnues en affection de longue durée (ALD) ;
- les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- les mineurs ;
- les professionnels de santé et leurs employés ainsi que les personnes travaillant en établissement de santé ou dans un service social ou médico-social, sous réserve de présenter une attestation sur l’honneur justifiant de leur fonction ;
- les personnes immunodéprimées, pour les examens de détection des anticorps ;
- les personnes faisant l’objet d’un dépistage collectif organisé.
- Le reste à charge pour l’assuré est déterminé en fonction du professionnel de santé délivrant le test. L’assuré devra payer 30 % du coût du test s’il est réalisé par un médecin ou un pharmacien et 40 % s’il l’est par un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute. Si vous bénéficiez d’une complémentaire santé (mutuelle) ou de la complémentaire santé solidaire, le ticket modérateur des tests Covid-19 est intégralement remboursé.
Ces nouvelles modalités s’appliquent en France métropolitaine ainsi que dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte.
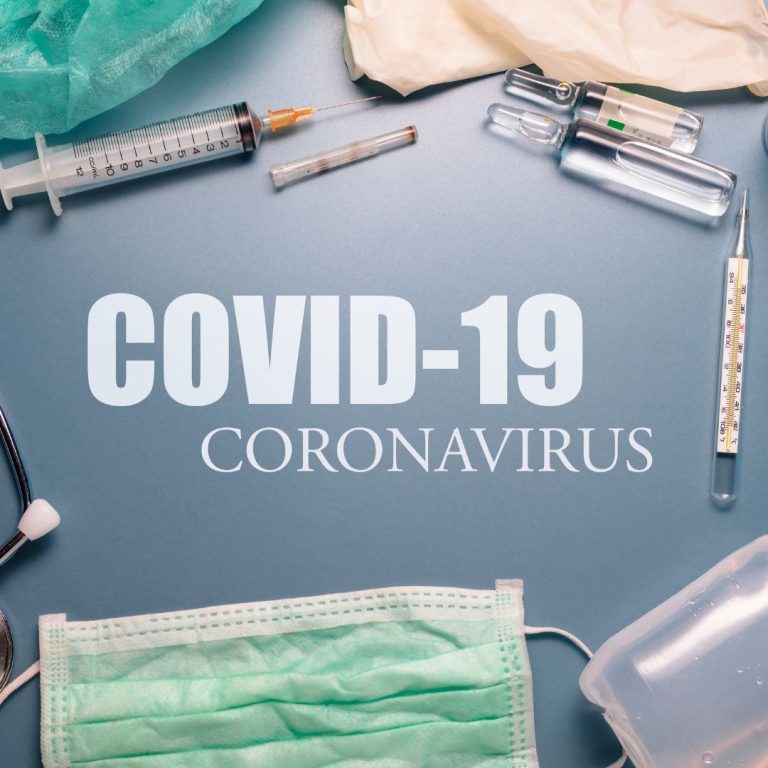
Sophia : le service d'accompagnement des diabétiques
Sophia est un service d’accompagnement destiné aux diabétiques proposé par l’Assurance maladie aux assurés de plus de 18 ans souffrant de diabète.
Ce service téléphonique aide les patients à mieux vivre la maladie au quotidien, en apportant notamment un soutien et des conseils. Ainsi, un infirmier-conseiller peut être contacté au téléphone par les patients diabétiques. Ceux-ci pourront avoir une réponse gratuite et personnalisée à leur demande.
Le programme Sophia a donc pour vocation de limiter les risques de complications liées au diabète et d’aider les patients à appliquer les recommandations du médecin traitant.
L’assuré qui souhaite bénéficier du service Sophia peut s’inscrire :
Par courrier, en envoyant le bulletin d’inscription rempli dans son enveloppe pré-affranchie
En ligne : via le module d’inscription ou depuis le compte ameli.

Certains préservatifs sont gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans dès janvier 2023 :
Depuis quelques semaines, les pharmaciens peuvent constater l’effet notable de la gratuité des préservatifs pour les jeunes de moins de 26 ans. Le mois dernier, selon les informations d’Europe 1, deux millions de préservatifs ont été écoulés gratuitement dans les officines, contre 500.000 en janvier 2022. À l’époque, une ordonnance était nécessaire pour en obtenir sans rien débourser. Mais depuis le 1er janvier 2023, tous les mineurs et les jeunes de moins de 26 ans peuvent en obtenir sur simple demande et de façon totalement gratuite. Le président Emmanuel Macron avait qualifié cette mesure de petite révolution.
90.000 bénéficiaires : Selon le ministère de la Santé, environ 90.000 jeunes ont pu bénéficier du dispositif en l’espace d’un mois, soit trois fois plus que l’année dernière. Cette fois-ci, plus de pharmacies participent à cette mesure de prévention puisque 16.000 d’entre elles ont délivré au moins une boîte de protection gratuite le mois dernier. Sur la même période l’année dernière, elles n’étaient que 12.000.

Après un début d’année marqué par une accalmie, l’épidémie de grippe a poursuivi ces derniers jours un rebond entamé. La semaine dernière a enregistré, en métropole, un « rebond de l’épidémie avec augmentation des indicateurs grippe en ville et à l’hôpital dans toutes les classes d’âge », selon un bilan hebdomadaire de Santé publique France. Outre-mer, elle se poursuit en Guyane et dans les Antilles. L’épidémie de grippe, qui avait commencé tôt en France, avait connu un repli en janvier.
Mais depuis deux semaines, elle repart et, en métropole, seuls la Normandie et les Hauts-de-France apparaissent en phase « post-épidémique » lors de laquelle la sortie de l’épidémie est envisageable à court terme. La Bretagne, notamment, est phase pleine épidémie après avoir commencé à en sortir les semaines précédentes.
L’épidémie a été particulièrement relancée par l’expansion d’une nouvelle souche, dite de type B, même si la première, de type A, reste présente.
Bronchiolite en déclin :
Le virus de type B « peut tout à fait réinfecter des personnes qui ont déjà eu des grippes de type A », avait expliqué la semaine dernière à l’AFP l’infectiologue Benjamin Davido.
Chaque hiver, 2 à 6 millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe. Selon les données du Réseau Sentinelles qui assure la surveillance épidémiologique de la grippe depuis 1984, entre 788 000 et 4,6 millions de personnes consultent pour syndrome grippal lors d’une épidémie de grippe. Entre 25 % et 50 % de ces consultations concernent des enfants de moins de 15 ans.
Quelque 10 000 décès liés à la grippe sont enregistrées chaque année en France. Plus de 90 % de ces décès surviennent chez des personnes âgées de plus de 65 ans.

Ordonnances orthoptiques et renouvellement par l’opticien : le décret est paru
Le décret du 26 avril relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans prescription médicale par les orthoptistes est paru aujourd’hui ou Journal Officiel. Il précise les conditions dans lesquelles ces professionnels pourront prescrire des lunettes ou des lentilles correctrices, comme le prévoit l’article 68 de la LFSS 2022, et celles dans lesquelles ces ordonnances pourront être renouvelées.
Le décret complète le code de la Santé publique de deux articles
L’article R. 4342-8-2 comporte les dispositions suivantes :
Le bilan visuel et la prescription prévus par l’article 68 de la LFSS 2022 peuvent être réalisés par l’orthoptiste pour les patients âgés de 16 ans à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par arrêté du ministre chargé de la Santé. Pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, ils ne peuvent être réalisés par l’orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de 5 ans. Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan réalisé par l’ophtalmologiste doit dater de moins de 3 ans.
Après un interrogatoire visant à établir l’absence d’une des contre-indications listées par l’arrêté et le respect des conditions mentionnées plus haut, l’orthoptiste peut procéder au bilan visuel qui comprend la mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction subjective et objective, ainsi qu’un examen simple de la motricité oculaire. Dans le cadre d’un bilan visuel préalable à la prescription de lentilles souples, l’orthoptiste devra réaliser en complément une mesure de la courbure de la cornée et un examen de la surface oculaire.
Le patient devra être orienté vers un ophtalmologiste si, lors de la réalisation du bilan visuel, l’orthoptiste constate l’existence d’une des contre-indications listées par l’arrêté ou de toute autre situation nécessitant une consultation médicale, une baisse de l’acuité visuelle profonde et brutale, ou le besoin d’une correction supérieure ou égale à 3D pour la myopie et l’hypermétropie, et à 1D pour l’astigmatisme.
En cas de prescription, l’orthoptiste précise sur l’ordonnance que celle-ci revêt un caractère non médical.
Pour un renouvellement d’équipement, l’orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact souples datant de moins de 2 ans. Il doit reporter sur l’ordonnance l’adaptation de correction qu’il réalise, indiquer ses noms, prénom, qualité, identifiant d’enregistrement, puis dater et signer cette modification. Il doit aussi en informer le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
L’article R. 4342-8-3 prévoit quant à lui que l’orthoptiste peut réaliser le dépistage de l’amblyopie mentionné pour les enfants âgés de 9 à 15 mois et le dépistage des troubles de la réfraction mentionné pour les enfants âgés de 30 mois à 5 ans. En cas de signe évocateur hors des limites de la normale, l’orthoptiste doit orienter l’enfant vers un ophtalmologiste.
Ce décret modifie en outre les textes relatifs aux prérogatives des opticiens
La délivrance de lentilles correctrices à une personne qui en porte pour la première fois est désormais subordonnée à la présentation d’une ordonnance « médicale ou orthoptique » (dont la durée de validité reste d’1 an quel que soit le prescripteur).
Pour une prescription orthoptique de lentilles, le délai durant lequel l’opticien peut adapter les corrections des patients de 16 ans et plus est fixé à 2 ans (il reste de 3 ans pour une prescription médicale).
La durée de validité de l’ordonnance orthoptique de verres correcteurs est fixée à deux ans.
Comme le médecin, l’orthoptiste peut limiter ou s’opposer au renouvellement des équipements par l’opticien par une mention expresse sur l’ordonnance.
Les autres modalités de renouvellement (mentions sur l’ordonnance, information du prescripteur, conservation de l’ordonnance) d’une prescription orthoptique sont identiques à celles fixées pour une prescription médicale.

Proposition de loi Rist : faciliter l’accès aux soins des patients, une évolution majeure soutenue par l’Ordre National des Infirmiers et le premier étage d’une réforme ambitieuse de notre système de santé
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS – Paris, le 15 février 2023
L’Ordre se félicite des avancées obtenues après l’examen par le Sénat de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, portée par la députée Stéphanie Rist, qui vise notamment à faire évoluer le champ de compétences des professionnels de santé pour garantir à tous des soins de proximité.
En France, il existe déjà une médecine à deux vitesses pour 6 millions de Français qui n’ont pas de médecin traitant, et 600 000 patients en affection de longue durée, une évolution qui s’accélère avec le vieillissement de la population.
En renforçant le rôle des Infirmiers de Pratique Avancée, dans le domaine de la primo-prescription, et de l’accès direct dans le cadre d’un exercice coordonné, le texte apporte des solutions concrètes et accessibles à tous les patients et concourt à la montée en compétences de la profession infirmière. L’Ordre se félicite également du vote, par le Sénat, de l’intégration des infirmiers au dispositif de permanence des soins ambulatoires.
L’Ordre souhaite néanmoins que la poursuite des débats en CMP permette la réintégration, dans les dispositions votées, des communautés professionnelles territoriales de santé au sein du cadre d’exercice coordonné dans lequel les IPA exerceront ces nouvelles compétences.
Il souhaite enfin la reconnaissance du premier recours pour les IPA, et soutient l’élargissement des transferts de compétences à toutes les spécialités infirmières, dans le respect des spécificités de leurs formations et de leurs pratiques.
Malgré le lobbying corporatiste de certaines organisations qui ont cherché à caricaturer, voire à dégrader l’image et le rôle des IPA auprès des patients, ce texte constitue une avancée significative en rendant effectif le partage des tâches entre les médecins et les professionnels paramédicaux et en favorisant, pour les patients, l’accès direct et rapide à un professionnel formé.
Evolution attendue de l’ensemble de la profession :
Les débats de qualité au Sénat ont montré que ces dispositions recueillaient un fort consensus, de nombreux sénateurs ayant insisté sur le fait que la mise en œuvre des réformes de la profession infirmière avaient tardé.
Ce texte ouvre la porte à l’évolution de l’ensemble de la profession. Pour Patrick Chamboredon, Président de l’Ordre National des Infirmiers, « cette proposition de loi ouvre la voie à des prises en charge rapides, au plus près du lieu de vie des patients, et garantit la continuité des prises en soins des malades chroniques. Ce sont des solutions qui ont fait leurs preuves à l’étranger. La montée en compétences de la profession infirmière est un gage de progrès et d’efficience de notre système de santé. La prochaine étape, c’est la révision du décret de compétences des infirmiers ».

